
Répétition à Mauvezin (Gers), article du 9 novembre 2007, par Christine Couderc

L’ARCHITECTE
Trois perspectives, trois niveaux différents dans la dramaturgie d’Ibsen :
L’ordre social : il constitue le cadre de vie des personnes. En règle générale, on nous introduit dans un milieu bourgeois bien établi. Mais il apparaît bientôt que ce monde est menacé de l’extérieur par quelque chose de nouveau, par un nouveau mode de pensée et par d’autres valeurs que celles qui sont généralement admises. Une nouvelle conception de la vie est en route.
L’idéologie : C’est sur ce second niveau que la nouveauté se fraye un passage, parce que, dans ce milieu établi, il existe un besoin fondamental de changement. Là nous voyons comment une troisième perspective, plus individuelle, prend forme lorsque cette orientation nouvelle s’insinue dans l’individu ; elle provoque des secousses non seulement dans sa propre vie, mais avant tout dans ses relations avec autrui.
Les pulsions psychologiques ont ainsi leur origine dans des circonstances idéologiques et sociologiques, on peut difficilement les comprendre en dehors d’elles. […]. Ses personnages ne combattent pas seulement contre des puissances intérieures, ce qu’il appelait leurs « démons » et leurs « trolls ». L’existence de ces personnages est étroitement liée aux idées, aux opinions et aux systèmes sociaux de l’époque. C’est précisément cette articulation des plans qui constitue l’essence et la perspective dans l’art d’Ibsen et qui en fait une composition existentielle avec aperçus sur de nombreux aspects de la vie de l’être humain en tant qu’individu et comme membre d’une communauté.
SOLEIL TROMPEUR
Des revenants en tant que tels, il est question quatre fois dans le drame. L’une de ces allusions, directe en l’occurrence, à l’acte II, donne une manière de programme selon lequel se précipitera l’action jusqu’à son dénouement. « Vieilles idées mortes », « vieilles croyances mortes », scènes qui se reproduisent exactement d’une génération à l’autre : nous sommes en territoire connu. Et les exégètes ont beau jeu de parler des théories en vogue à l’époque, sur l’hérédité notamment. Je ferai seulement remarquer qu’Ibsen est plus fort que ces Messieurs de la Salpêtrière, en raison de sa culture scandinave. Le Moyen Age nordique a connu une catégorie tout à fait remarquable de « revenants » qui étaient de véritables morts-vivants susceptibles de venir fréquenter, pour diverses raisons, les lieux où ils avaient vécu : il n’est pas exclu que la confusion de Manders croyant revoir Alving dans le fils de celui-ci, Osvald, remonte à cette croyance. Mais au total, cela ne fait pas beaucoup de revenants, même si la thématique profonde de la pièce, une fois de plus, ne parle sans doute que de cela.
En fait, l’image, ou plutôt le registre iconique, qui obsède littéralement la pièce est celui du Soleil / de la lumière / de l’incendie, dont je compte au moins une quinzaine d’évocations directes ou métaphoriques transparentes, ou a contrario par le biais de l’obscurité intolérable. Il faut rappeler que le Soleil, notion féminine dans les langues germaniques, est très certainement la figuration la plus ancienne, la plus chérie des enfants du Nord (…). Jamais « elle » n’est hostile à l’homme ou destructrice sous ces latitudes, « elle » est toujours vue avec sollicitude et affection. En fait, « elle » est la joie de vivre, cette joie de vivre dont on ne se lassera jamais de répéter qu’elle constitue le fond véritable de la pièce : ce n’est pas à lutter contre les revenants que s’emploie Ibsen, c’est à exalter la joie de vivre - cette joie qu’Osvald a découverte à Paris, comme finit par l’admettre Madame Alving. D’ailleurs, cela nous est explicitement dit, nos malheurs viennent non pas des revenants, mais de ce que « nous avons si lamentablement peur de la lumière ». Ou encore, à mesure que la tragédie s’achemine vers son terme, à mesure que la crise d’Osvald se consomme lamentablement, voyez comme le soleil fait irruption en force. Il obsède absolument les dernières pages du texte, tout comme il fascine le pauvre idiot prostré avant la chute finale du rideau.
Soleil invisible, soleil de splendeur et de bonheur. Soleil implacable aussi, de destruction et de purification. Et ici, c’est l’autre image, celle de l’incendie, le feu comme le soleil, qui s’impose. Incendie de l’asile, bien entendu, au sens propre, avec préliminaire (préparation de l’image en un sens) et cruelle consommation. On peut dire que les deux faces du feu sont présentes : positive sous les espèces du Soleil-joie-de-vivre, négative dans l’image de l’incendie. Mais une justice règne : cet incendie est légitimé par tous les faux-semblants, mensonges, toute cette hypocrisie dont Engstrand est l’expression.
Lien internet : http://www.theatre13 et présentation et intention du metteur en scène : http://www.theatreonline.com
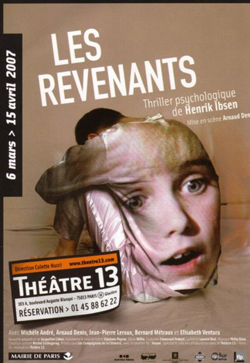
Commentaire : http://www.blogger.com
Autre témoignage : http://www.billetreduc.com
2013 :
Les Revenants, c’est d’abord UN revenant, le fils prodigue, Osvald, joué par Eric Caravaca, qui retourne auprès de sa mère, Frau Alving (Valérie Dréville) dans la maison familiale, isolée au bord d’un fjord. Frau Alving s’apprête à inaugurer, le lendemain, un orphelinat en mémoire de feu son mari, le Capitaine et Sénateur Alving. Dans la maison, une charmante bonne, Régine, c’est Mélodie Richard, à laquelle Osvald n’est pas du tout insensible. Il faut y ajouter le pasteur Manders, François Loriquer, vieil ami de la famille, et le père de Régine, le Menuisier Engstrand, Jean-Pierre Gos, et la distribution est complète.
Evidemment, comme on est chez Ibsen, de lourds et scandaleux secrets ne vont pas tarder à revenir à la surface, voici d’autres revenants, d’autant que si Osvald est revenu chez sa mère, c’est parce qu’il porte en lui une maladie aussi honteuse que mortelle, dont l’origine est sans doute à chercher du côté des turpitudes paternelles. « Les fautes des pères retombent sur leur enfant » est d’ailleurs une des répliques et un des thèmes majeurs de la pièce.
La pièce, écrite en 1881, avait fait scandale à l’époque à cause de ce qu’Ibsen dévoilait de la face cachée de la bonne bourgeoisie. Dans l’adaptation qui en est faite par Thomas Thomas Ostermeier et Olivier Cadiot, en fait la traduction en français d’une première adaptation du texte par Ostermeier pour la troupe néerlandaise du Toneelgroep d’Ivo van Hove à Amsterdam, Osvald est vidéaste, ce qui permet à la mise en scène de jouer avec l’image vidéo, filmée et projetée en direct sur scène, ou faisant office de décor mouvant sur les trois pans de mur, plus un grand carré en bois. Au milieu, un espace de réception, salle à manger d’un côté, salon de l’autre, installé sur un plateau tournant, qui ne se prive pas de tourner, beaucoup. Une scénographie du vieux complice d’Ostermeier, Jan Pappelbaum.
Ostermeier affectionne particulièrement les pièces d’Henrik Ibsen. C’est sa sixième incursion dans l’univers du Norvégien, depuis Nora, Une maison de poupée en 2002, en passant par Solness le constructeur (pour la télévision autrichienne), Hedda Gabler, John Gabriel Borkman et Un ennemi du peuple l’an dernier.
Antoine Guillot