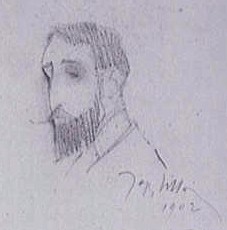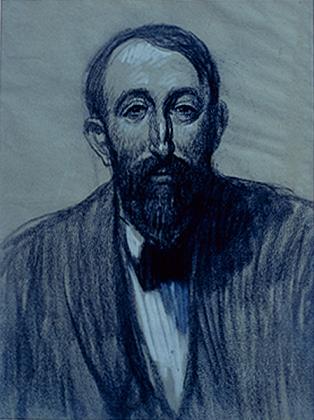Oratorio pour un argot lyrique
Quand Antoine
Chapelot m’a contacté pour me proposer de le diriger sur sa prochaine création, à partir de textes choisis dans le recueil Soliloques du pauvre d’un illustre inconnu, j’ai tout d’abord refusé pour des raisons d’indisponibilités et ensuite parce que cette écriture me paraissait injouable. Son insistance a éveillé ma curiosité et j’ai commencé à m’intéresser à l’auteur, Gabriel Randon mieux connu sous son pseudonyme : Jehan-Rictus.
Ayant un projet de montage poétique sur les textes de Baudelaire (1), j’étais sensibilisé à cette période – la Commune, Jules Valles, Courbet, les débuts de l’électricité dans les théâtres, la photographie, Zola, l’avènement de la mise en scène – où les germes de la psychanalyse – l’arrivée de Freud à Paris pour étudier auprès de Charcot – et la pensée de Marx, allaient révolutionner le siècle suivant. Epoque charnière qui stigmatise la place du corps dans une société en plein développement industriel.
La découverte des textes de Jehan-Rictus par la voix d’Antoine
Chapelot créa un engouement similaire à ce que je ressentis à la lecture des textes de mon défunt ami, le poète Chris Marvil, à partir desquels je montais le spectacle Soyons sérieux pour de rire. La langue du poète parisien et son projet autant poétique que politique – « Faire enfin dire quelque chose à quelqu’un qui serait le Pauvre, ce bon Pauvre dont tout le monde parle et qui se tait toujours. Voilà ce que j’ai tenté. », indique-t-il en exergue de ses soliloques – est fournie, chaleureuse, colorée, elle tente de restituer la parole de la rue, des petites gens, de ceux qu’on n’entend pas.
Y faut secouer au cœur des Hommes
Le dieu qui pionc’ dans chacun d’nous ! (2)
Comment répondre à cette injonction, à ce programme ? Le théâtre trouve alors à mes yeux sa justification. Correspondre à l’« implacable franchise » de ce témoin qui écrit dans « Conseils » : « Pas de pain blanc sans les mains noires (3) », sans apitoiement, sans exagération, parce que si la misère est nauséabonde, la pauvreté est digne. La pauvreté n’est qu’une déficience de l’avoir, elle est toute relative, se juge à l’aune d’une comparaison bien subjective…
Faire voir ce qu’on ne voit pas
 |
Il ne s’agit pas de mettre en scène un pauvre, mais de montrer la pauvreté, son espérance. Qu’est-ce qui symbolise la pauvreté aujourd’hui ? Comment traduire sur scène la pauvreté sans tomber dans les clichés ? L’enfermement dans le préjugé que constitue la pauvreté – autant que peut l’être la folie – m’a évoqué dans le quotidien, l’objet téléviseur.
La télévision, un écran, tel le texte lui-même écran d’un autre type. Tous les projecteurs sont dirigés sur l’acteur, coryphée d’un chœur invisible qui n’est autre que la communauté des spectateurs qui s’ignorent. Nous avons choisi d’exhiber la pauvreté et d’exhiber le dispositif qui la révèle pour montrer que l’intention absolue de sincérité conduit à l’outrance, et donc, à une contre-vérité. Paradoxalement, l’authenticité est menacée et nous menace. Concomitamment à ce qui se joue sur scène, une image parcellaire est retransmise. |
Le pauvre offre l’insaisissable image fragmentée de son identité et de la pauvreté ; « l’alternative demeure, qui oppose […] en termes psychanalytiques, les processus du narcissisme (l’image comme redoublement) et du fétichisme (l’image comme substitut du manque) (4)». La pauvreté n’est-elle pas justement signifiante par le manque qu’elle suggère ?
Un téléviseur, une simple fenêtre qui rappelle de manière générique tous les autres écrans. Il y a ce qu’on perçoit, fugitivement ou non, ce qu’on choisit de montrer intentionnellement ou pas, ce que le hasard nous propose irrémédiablement de voir ou non. L’illusion nous échappe autant que le réel. Réalité de la scène, vérité des présences. Oubli des images (5).
Antoine
Chapelot interprète RICTUS, seul, avec comme compagne, une grille, symbole de civilisation et d’exclusion. Le personnage Rictus – à la croisée du Quijote et des clochards de Beckett, espèce de pirate naufragé de la société humaine – cherche à sortir (et peut-être aussi de lui-même) ses impressions, fait émerger ses mots - d'ange déchu ? - (qu’on lui impose – dépose sur lui – et ceux qu'il a appris), comme des grappins ; le grillage – cage, échelle, harpe-lyre – l’oblige à résister, parce qu’il s’y cogne, parce qu’il s’y accroche. La voix agit comme un rehausseur, tandis que le silence semble délimiter le véritable territoire de sa parole.
Qu’est-ce qu’il peut faire d’autre que rire ? Se mettre en colère ? Quand la colère est usée jusqu’au bout, que sa douleur ne lui permet même plus l’emportement, ne reste que le rire, son immensité, son incongruité, une espèce de folie irrésolue car trop raisonnée, inattendue car trop évitée. La pauvreté nourrit la moquerie, le mépris, la peur et la haine de ceux qui la fuit. L’impénétrable violence sourd continuellement de ce spectacle. Nous ne voulons ni la mièvrerie, ni une prédisposition au consensus : ce que nous voulons provoquer, c’est un frémissement des lignes, un bousculement des limites, un déraisonnement des sens, faute d’arraisonner les vertiges.
J’ai beau m’trémousser, j’ai pas l’rond,
Je suis tremblant, je suis traqué,
J’suis l’Déclassé,… l’gas distingué
Qui la fait à la poésie :
J’suis aux trois quarts écrabouillé
Ent’ le Borgeois et l’Ovréier,
J’suis l’gas dont on hait le labeur,
Je suis un placard à Douleurs,
Je suis l’Artiste, le Rêveur,
Le Lépreux des Démocraties (6) |
|
Reste la rencontre avec le public. Pour une pauvreté non prostituée, ni médiatisée, de celle qui lie soudainement la communauté théâtrale au cœur de l’intimité des existences.
Michaël
Therrat, le 20/02/2009
(1) Charles Baudelaire interroge, dans Fusées : « Qu’est-ce que l’art ? Prostitution. », in Journaux intimes, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1975, p.649 ; (2) Jehan-Rictus, Les Soliloques du Pauvre [basé sur l’édition de 1903], Paris, Éditions Blusson, [2007] ; (3) Jehan-Rictus, ... le Cœur populaire, Paris, Éditions Blusson, [2007] ; (4) Frédéric Maurin cité par Patrice Pavis dans La Mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives, Paris, Armand Colin, coll. « U. Lettres », 2007, p.143-144 ; (5) Pour cette prégnance de la télévision, voir Didi-Huberman qui dit que lorsque nous regardons devant, nous regardons dedans, que lorsque nous voyons nous pensons en terme d’acquisition alors que l’expérience du « voir » englobe une perception d’être qui nous fait sentir irrémédiablement que quelque chose nous échappe, et donc qu’il y a perte. C’est cela l’objet télévision sur la scène de RICTUS. Un objet démodé, anachronique bien entendu, où l’image grésille, l’écran évoquant aussi le frémissement de l’avenir en gestation. Une gestation morne ; (6) Jehan-Rictus, Les Soliloques du Pauvre, op. cit. , p.150.
Notes, du 20 mai 2009, du 17 novembre 2009, du 28 novembre 2009 & articles de presse /2009
|